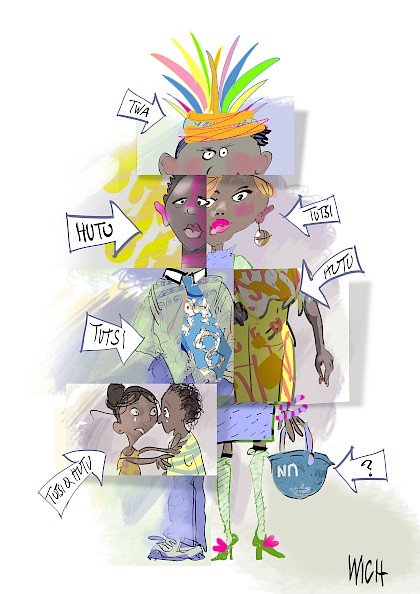«Oh Capitaine, mon Capitaine » Pourquoi faut-il relire Walt Whitman ?
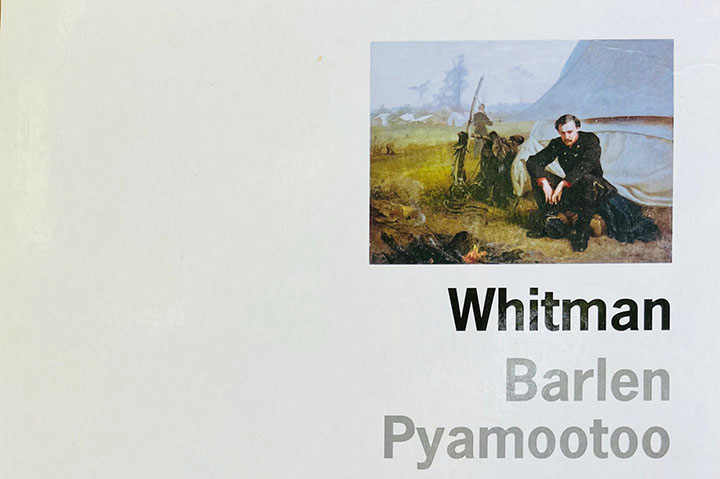
Aux Editions de l’Olivier paraissait en 2019 un « Whitman »,
quatrième livre de l’écrivain mauricien Barlen Pyamootoo.
Occasion réussie de nous rappeler l’urgence de se replonger dans l’œuvre poétique de Walt Whitman, sorte de Paul Verlaine américain, porteur de formules inédites sur la beauté des choses et de leurs destinées. Les émotions les plus légères et les plus profondes ponctuent et font résonner ses vers, toujours empreints de ce qui dérangera le puritain et exaltera dans le même temps les amoureux fous de liberté. Tandis que les auteurs établis du 19ème siècle comme Emily Dickinson ou Mark Twain omettrons souvent de le citer en leur références, tant sa grandeur écrase, il faudra des Oscar Wilde pour en célébrer l’essentielle importance.
Dans ce court roman de Pyamootoo, nous suivons le poète, déjà reconnu par ses premiers livres comme « The Child’s Champion », dans les aléas qu’entrainent la recherche de son frère George, blessé lors de la plus sanglante bataille de la guerre de Sécession, celle de Fredericksburg en Virginie (1862).
Nous visitons avec lui les hôpitaux militaires de Washington et les camps de blessés en bordure des champs de bataille. Nous réconfortons avec lui les enfants de l’Amérique qui meurent avant d’avoir goûté à la vie et au vaste monde. Walt adopte en son cœur tous ces jeunes frères agonisants à qui il tient la main, à qui il parle sans fin, le tout dans un décor d’apocalypse où les amputations et les gangrènes s’enchaînent au rythme infernal du quotidien.
Ces soldats sont des enfants, même les hommes le redeviennent dans la solitude de leurs souffrances et de leurs peurs.
Pyamootoo tente ici la relation d’une période initiatique à l’origine de ce qui restera le style même de l’écrivain : l’étrange fruit né de l’exaltation empathique envers le spectacle de la douleur, le désespoir, la vie, les êtres et leur misère, envers la moindre trace d’existence qu’elle fût tempête en mer ou feuille morte oubliée de tous.
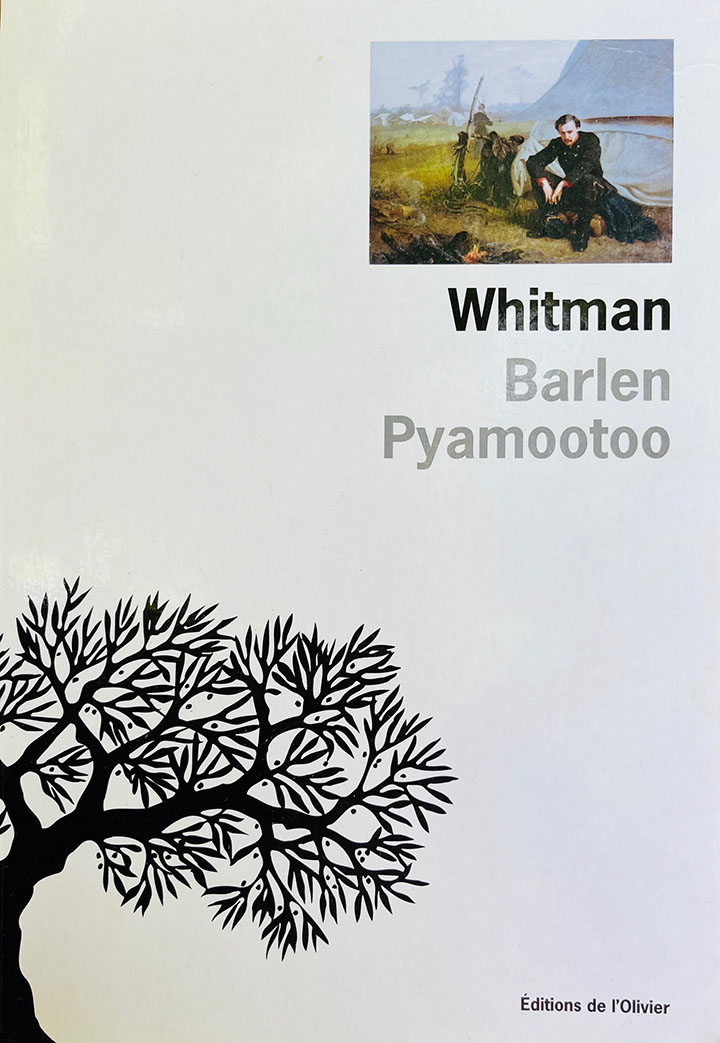
Rarement un livre n’aura montré autant de moments de réconfort, de bras ouverts avant de se refermer en étreintes déchirantes, autant de simplicité aussi, qui ne permet aucune vaine emphase. Inutile de tenter de dire ce qui porte Walt de jour en jour, lui qui retrouvera presque banalement le frère aimé, sain et debout.
Inutile, car c’est bien là toute la force, toute la puissance de l’œuvre de Whitman dans sa globalité. Cette indéfectible foi que possède l’auteur de « Feuilles d’Herbe » dans les bontés toujours possibles et dans l’amour toujours présent en toute chose.
Cette franche et tendre camaraderie, étalée sans a priori, pour ne pas dire sans complexe, tout au long du récit, et propre aux livres de Whitman, a pu être dénoncée parfois et par certains comme la résultante pesante et affectée de son homosexualité. Le terme même, dont l’usage n’existait pas encore, ne suffirait pas à approcher seulement cette ferveur authentique qui était la sienne et qui donnera à son poème « Ô Captain » un élan patriotique mêlé d’une effrénée tendresse et qui aura ému des générations d’américains.
Ô mon capitaine
C’en est fini du terrible voyage mon Capitaine
Essuyés tous les grains, remportés tous les gains
Par notre vaisseau
Le but est proche, sonnent les cloches
la foule en liesse suit la lisse, audacieuse et droite glisse la quille
Mais ce saignement rouge, ô mon cœur,
Mon pauvre, pauvre cœur,
Sur le pont où mon capitaine est couché,
Cadavre froid et raide
Whitman compose ces ligne à la mort du Président Lincoln, celui dont il a porté les valeurs de démocratie et tous les combats contre l’esclavagisme.
Abraham Lincoln est mort assassiné ! Nous sommes le 15 avril 1865.
Debout ! mon capitaine, entends les cloches,
Lève-toi, c’est pour toi que claquent ces flammes,
Pour toi que trillent ces clairons
Pour toi ces bouquets, ces tresses, ces couronnes
Et ce rivage noir de monde
Qui t’acclame, cette fluctuante masse de visages anxieux,
Ecoute-les, père chéri, écoute-moi,
Je passe mon bras sous ta nuque !
Non, c’est un rêve, tu n’es pas mort,
Tu n’es ni raide ni froid sur ce pont !
Mais lui ne répond pas, ses lèvres demeurent pâles,
Il ne sent pas mon bras, mon père, son pouls ne bat plus,
Sagement à l’ancre, route terrible accomplie,
Son vaisseau est au but, la victoire est acquise
Rivages, exultez ! Cloches, résonnez
D’un pas de feutre, pour moi, je foule
Le pont où l’on a étendu le cadavre,
Mon capitaine, par la mort roidi.
La traduction fait ce qu’elle peut. Et s’est perdue, sans aucun doute ici, la chanson même de la langue. Perdus aussi la rime, le ton rugueux d’une époque et cette manière répétitive, lancinante et presque hypnotique si particulière à Whitman.
Même chez nous, on se souvient encore de ces lignes qui ont fait vibrer un certain film.
Succès du box office, « Le Cercle des Poètes Disparus », qui a fait pleurer chacun dans le souvenir ému de son adolescence, n’a pour autant pas évité quelques hypocrisies, si on daigne regarder en face le génie de Whitman et ce qui l’a nourri.
Car, en effet, voir en toute chose le divin, c’est à dire l’amour universel, est plutôt risqué pour le commun des mortels, surtout quand il est américain. Si le professeur faussement libertaire (joué par Robin Williams) prend des allures de non-conformiste en proposant à ses élèves/disciples d’arracher dans l’Anthologie (cet herbier censé rassembler les plus belles fleurs de la langue), les pages occupées par des auteurs considérés comme médiocres, il réalise lui aussi, à mon sens, une censure envers celui qui n’attend peut-être qu’à apprendre à penser par lui-même.
On se rappelle en effet, dans un film bien plus honnête et audacieux, « Maurice » de James Ivory, une censure semblable en apparence, et sans doute plus profonde encore, parce qu’étant assumée par toute l’institution et toute la société dont elle est l’émanation.
Ici, la censure en question est décrite pour ce qu’elle est…
Le professeur d’Histoire de la Philosophie d’une université du genre Oxford, recevant en son bureau quelques élèves afin d’évoquer les philosophes de l’antique Athènes, propose de « sauter » quelques pages qui, malencontreusement, évoquent le « vice Grec » (que d’autres -français- appellent aussi le « mal anglais »). Les étudiants se montrent obéissants mais néanmoins moins « disciples » que ceux du Cercle, puisque l’un d’eux, seul contrairement aux autres, comprend clairement ce qui condamne les pages incriminées, se souvenant, troublé, de l’abîme azuré des yeux d’un camarade…
Ici, nous sommes dans l’Angleterre du début du XXème siècle ; là nous étions aux Etats-Unis vers 1959.
Dans « le Cercle des Poètes Disparus », le fait d’étaler tout au long du film cette tendre camaraderie que les bienpensants trouvaient dérangeante chez Whitman, sans être jamais nommée comme la sensualité qu’elle sera peut-être un jour, ou la naissance du désir qu’elle sera de toutes façons, me semble aussi fourbe que le fait de porter comme étendard le fameux poème « Oh Mon Capitaine ! », jeté dans le même temps à la mémoire de tous les américains, d’une part, et au cœur de quelques initiés, d’autre part.
« Nous avons l’Art pour ne pas mourir de la Vérité », écrira un jour Nietzsche.
Whitman nous disait alors que dans les parcelles infimes du monde, se loge la beauté d’exister.
Né à Long Island, dans l’état de New York en 1819, celui qui est encore considéré aujourd’hui comme le plus grand poète de l’Amérique, l’est surtout pour Leaves of Grass (Feuilles d’Herbe). Ce recueil magistral de poèmes a été remanié par son auteur à huit reprises jusqu’à sa dernière édition peu avant son décès en 1892 et est considéré encore aujourd’hui comme son chef-d’œuvre.
Boris Almayer
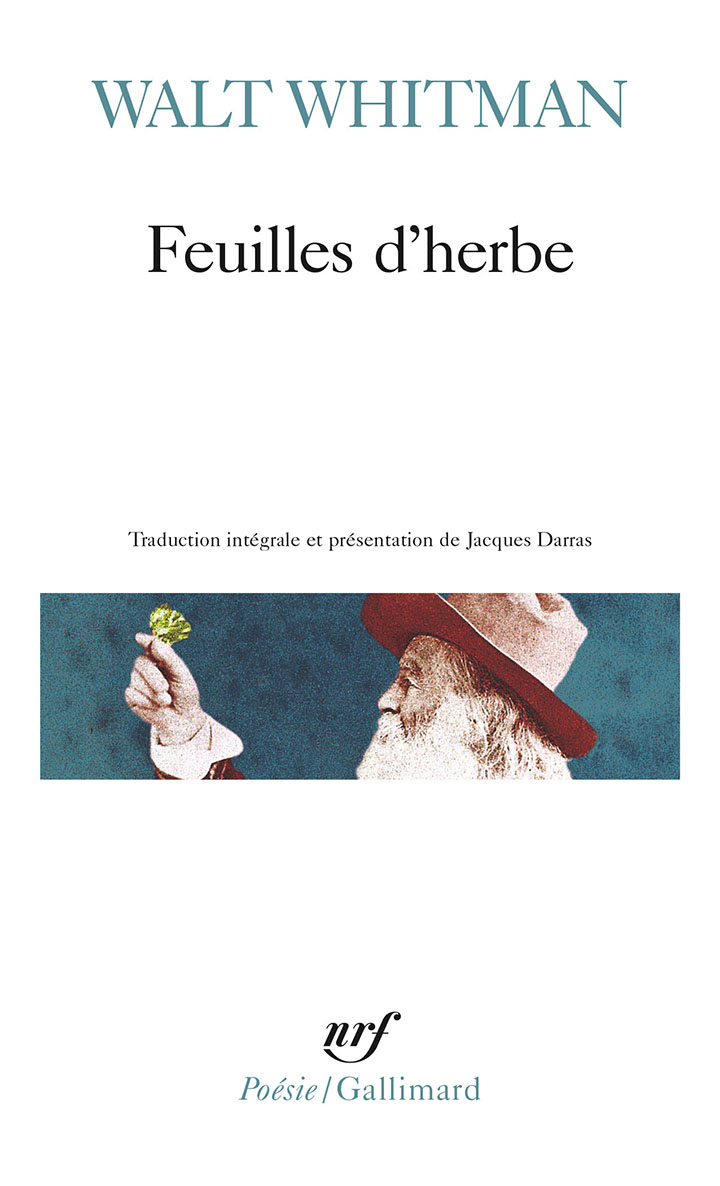
Original version-1865
O Captain! My Captain!
O Captain! My Captain! our fearful trip is done;
The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won;
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
Il semble que vous appréciez cet article
Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.
Merci !
O Captain! My Captain! rise up and hear the bells;
Rise up — for you the flag is flung — for you the bugle trills;
For you bouquets and ribbon'd wreaths — for you the shores a-crowding
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head;
It is some dream that on the deck,
You've fallen cold and dead.
My Captain does not answer, his lips are pale and still;
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will;
The ship is anchor'd safe and sound, its voyage closed and done;
From fearful trip the victor ship comes in with object won
Exult, O shores, and ring, O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
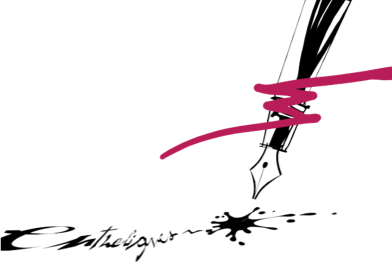
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.
Chaque samedi le meilleur de la semaine.
/ Du même auteur /
-

Brieuc Dufour et Florence Libotte
-

Isabelle Happart, le Temps retrouvé
-

Henri Van Eepoel
-

Bill Viola ou le chant silencieux de l’humanisme
-

Lionel Vinche à Marilles
-

Paul Dumont - Monotype
-

Félix Hannaert-Travaux 2017/2022
-

Trouver sa place
-

-Le crabe aux pinces d’homme- Un nouvel album de Gérard Manset
-

Le Pont d’Ambrussum de Gustave Courbet, Ou peut-être le plus beau tableau du monde
/ humeurs /
/ photos /
/ Commentaires /
Avant de commencer…
Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.
Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement.
Pour en savoir plus, cliquez ici.