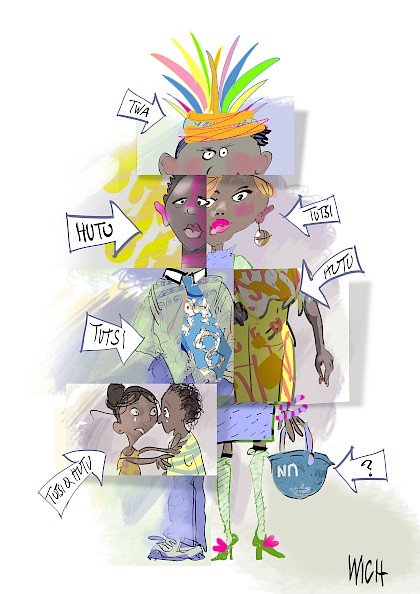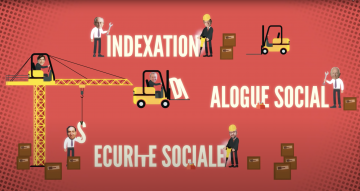Mon quart d’heure réactionnaire

C'est vrai, quoi: le travail à la chaîne, ce n'est pas drôle tous les jours.
Vous avez pu lire en ces pages, la semaine dernière, quelques considérations sur l’intelligence artificielle (IA), que l’on nous présente comme le nec plus ultra du progrès scientifique à venir. Dans un registre à peine différent, la multiplication des ouvrages, articles et conférences sur le transhumanisme connaît une popularité béate chez bon nombre de nos estimables contemporains. Certes, les exemples ne manquent pas qui démontrent combien l’humain est perfectible. Mais faut-il pour autant en modifier la nature intrinsèque ? Concernant l’IA, ses défenseurs mettent toujours en avant les bienfaits de ce progrès dans les applications médicales pointues, pour citer un exemple. On évoque plus rarement la robotisation galopante de l’industrie qui conduit directement au chômage (quand c’est possible, sinon au rebut) des cohortes de travailleurs sacrifiés sur l’autel de la productivité. Comme chacun sait, les robots « intelligents » ne font pas grève, ne s’arrêtent pas pour aller aux toilettes et n’arrivent jamais en retard au travail. Le rêve. Ils parlent tous couramment le langage C ou C++ et les plus futés, les « robots cartésiens », se débrouillent très bien en G-code. Fini les problèmes linguistiques à l’usine ! Conclusion : vive le progrès et tant pis pour ceux qui n’auront pas su s’adapter : qu’ils crèvent.
Citius, altius, fortius
Beaucoup de gens se disent, de bonne foi, progressistes. Mais le progrès, c’est quoi ? Vaste question. Cette notion s’est laissée absorber dans une vacuité de sens qui arrange bien du monde.
Le Candide de service pourrait penser qu’il y a progrès dès lors que tout ce qui vit sur terre gagne en confort et en plaisir. Le plaisir n’est-il pas un objectif admirable pour l’existence? Et le confort, face à la lutte quotidienne contre les éléments hostiles, n’est-il pas une aspiration bien légitime ? C’est certainement sur ces bases que la recherche du progrès a débuté. Une telle idée nous semble, aujourd’hui, relever de l’utopie ou d’une naïveté risible. Depuis l’apparition de la roue et des outils, le progrès se mesure davantage en avancées techniques qu’en termes de bien-être (sauf au Bhoutan). Jusqu’à un certain stade, on pouvait admettre que la technique représentait un progrès, à tout le moins pour certaines catégories de personnes. Les outils déjà cités, les moyens de communication, la médecine...
Toutefois, avec le temps et la marchandisation généralisée des techniques, le progrès s’est éloigné de l’intérêt général pour servir les intérêts commerciaux. Il s’est aussi détaché de l’utilité pour se focaliser sur la rentabilité. Les citoyens n’ont désormais plus voix au chapitre en ce qui concerne les objets du progrès. Ce n’est plus eux qui décident de ce qui est bon, mais les entreprises, en fonction de ce qui leur rapporte. Certes, chacun sait cela. Mais il est parfois bon de le rappeler en termes clairs.
Dès les années 1950, Jacques Ellul expliquait déjà que la technique, non seulement finit par asservir plutôt qu’à aider, mais est elle-même victime de sa propre finitude. Les nouvelles techniques engendrent de nouveaux problèmes, pour résoudre lesquels il faut trouver de nouvelles techniques. Elles se trouvent également dans une situation de concurrence. La course à la performance technologique est en réalité une course à l’échalote, dont les actionnaires des fabricants sont – jusqu’à nouvel ordre – les seuls réels bénéficiaires. Mais à quel prix ? Au prix d’une impasse.
Le progrès régressif
Le progrès technico-commercial n’est pas infini. Il se heurte, ou se heurtera, à la limitation des ressources, qu’il s’agisse des ressources naturelles, humaines ou celles que contient le portefeuille des consommateurs. Il y a hélas bien longtemps que le « progrès » ne profite plus au bien commun. Les avancées technologiques ultra-rapides creusent toujours davantage le fossé entre les pauvres et les riches, et notamment en matière d’accès au savoir, à la connaissance. Quant aux progrès de la médecine, l’essentiel de la recherche médicale étant désormais effectuée (ou financée) par les laboratoires pharmaceutiques, il ne faut pas s’étonner que l’on investit davantage dans les médicaments qui diminuent le cholestérol que dans les traitements contre la malaria ou les maladies orphelines, jugés non rentables. Ainsi, le « Rapport de la mission sur la refonte du système français de contrôle de l'efficacité et de la sécurité des médicaments » (ouf !) présenté au Sénat en 2011, a pu constater que « Les laboratoires français (...) ne produisent pour l’essentiel, que des quasi- copies (...) et des molécules sans intérêt notable pour la santé (...). Rapportée aux 1.630 versions commercialisées, (...) on passe à 1.200 molécules commercialisées sans intérêt. C’est pourtant alors que l’industrie pharmaceutique, qui ne découvrait plus guère, devint un géant du capitalisme, avec ses milliers de milliards de chiffres d’affaire et ses 100 milliards de bénéfices annuels».
Face à cette vision mercantiliste, on peut reprendre l’idée d’Ellul, selon qui le progrès technique se dissocie complètement de l’invention – cette dernière étant le véritable creuset d’un progrès possible. Dès lors, le progrès technique est antinomique du progrès humain et constitue une régression. Par l’asservissement qu’il entraîne, il appauvrit également la connaissance, puisque l’homme ne doit plus réfléchir pour résoudre les difficultés. Nous devenons des moutons qui broutent une herbe éternellement verte, mais truffée de brins toujours plus nombreux de gazon synthétique et breveté. Bon appétit.
Dans le même ordre d’idées, on peut citer le secteur économique qui a produit les plus grosses fortunes du monde : l’informatique. L’obsolescence programmée, qui rend appareils, logiciels et systèmes d’exploitation inutilisables au bout d’environ, disons, 5 ans, est une pratique parfaitement immorale, une escroquerie planétaire sans précédent qui dure depuis bientôt 100 ans. En un siècle, aucun élu, aucun juriste, aucun « homme de bien » n’a fait quoi que ce soit pour empêcher cette arnaque, bien difficile à discerner il est vrai. Mais en 100 ans, tout de même...
L’État privatisé
Pire : aujourd’hui, nos États eux-mêmes, par l’informatisation et la dématérialisation de toutes les données et de tous les documents, se sont rendus esclaves des multinationales de l’informatique. Imagine-t-on un État voter une loi limitant l’action de ses fournisseurs les plus stratégiques ? On peut comprendre et justifier l’idée de la dématérialisation (sauvegarder la forêt amazonienne, réduire l’espace de stockage, faciliter les recherches...), mais pourquoi les services publics ne recourent-ils pas massivement aux logiciels libres ? Cherchez l’erreur... Et cette erreur est funeste. Elle l’est d’autant plus que, comme d’autres auteurs l’ont largement démontré[1], la finalité de la plupart des producteurs de services IT est la collecte des données des utilisateurs à des fins commerciales et publicitaires (dans un premier temps). On imagine dès lors les risques sous-tendus par les accords passés entre les gouvernements et Google ou Microsoft, pour ne citer qu’eux.
Inutile d’assommer le lecteur avec des centaines d’exemples : on comprend bien le mécanisme pervers du « progrès régressif ». Il est évident qu’un tel système est appelé à s’autodétruire, mais que cette extrémité engendrera une casse certaine dès lors que nos sociétés occidentales reposent quasi entièrement sur les « acquis du progrès » technique.
Il appartient aux humains sages et avisés de réfléchir dès aujourd’hui à un modèle alternatif, volontariste et détaché de la doxa décrite ci-dessus selon laquelle « les choses finissent toujours par s’arranger » et qu’on « trouvera bien une solution ». On a bien vu ce qu’a donné la « main invisible du marché » lors de la crise bancaire et financière... Elle était bien contente de trouver tendue la main visible de l’État !
Créer un modèle alternatif, c’est ce que tentent de faire, sous les quolibets, les « objecteurs de croissance », des précurseurs qui, en prenant le contre-pied total du modèle dominant, proposent de diriger la société vers la « simplicité heureuse ». On peut apprécier ou non leur vision, mais il faut lui reconnaître la vertu de prendre en compte le bien commun. La difficulté que rencontrent les initiatives de ce genre, c’est la puissance de feu que peuvent déployer les tenants du modèle dominant pour anéantir toute velléité d’offrir une alternative.
Avec la chambre de résonnance que leur procurent les médias (qu’ils font vivre grâce à la publicité), ces derniers recourent à des techniques éprouvées de désinformation pour tourner en dérision chaque projet risquant de menacer leur hégémonie. Riccardo Petrella et Philippe de Woot, éminents professeurs d’université et fondateurs du Groupe de Lisbonne, se sont vu tournés en dérision de façon éhontée après avoir publié leur manifeste « Le bien commun ». Plus récemment, l’économiste Thomas Piketty, qui prône une taxation progressive du capital, s’est vu traité de « marxiste de sous-préfecture » par l’éditorialiste et activiste de la droite libérale Nicolas Baverez. Quand il n’y a plus d’arguments, il reste l’insulte... Les écologistes sont l’objet de railleries incessantes sur Internet, souvent au-delà des limites de ce que la bienséance permet. Le GIEC, groupe intergouvernemental de savants de haut vol qui tire régulièrement la sonnette d’alarme à propos des dangers du réchauffement climatique, est systématiquement mis en doute par un quarteron de climatosceptiques parce qu’un jour, il aurait fait une erreur de calcul parmi les millions d’opérations qu’il produit chaque jour. Parfois, ce sont les mots qui sont moqués : « développement durable » (un machin qui veut tout dire et rien dire, pour ses détracteurs), « pensée unique » (ce terme, qui désignait clairement le modèle hégémoniste de l’économisme, a été vidé de son sens par ceux-là même qu’il désignait), « objecteurs de croissance » (des hurluberlus qui veulent revenir à l’âge de la pierre), etc. Cela peut aller jusqu’à l’intimidation et aux recours à la justice, comme l’a souvent démontré Monsanto via ses retentissants procès contre des fermiers contaminés malgré eux par les OGM brevetés de la firme et contraints dès lors de lui verser des royalties... Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage, écrivait La Fontaine, décidément jamais démodé.
Le cri Nobel
Le progrès régressif est une nouveauté dans l’histoire humaine, le début d’une régression historique une fois passé le climax d’une évolution vers un mieux être global. Christian de Duve, Prix Nobel de Médecine 1974, déclarait dans la dernière interview qu’il donna au « Soir », peu avant sa « mort choisie » à 96 ans :
« On était quelques milliers dans le cœur de l’Afrique il y a 100.000 ans, et on est presque 8 milliards à occuper tous les endroits habitables de la Terre, à utiliser toutes les ressources disponibles jusqu’à les épuiser, à vider des océans de poissons, polluer l’environnement, le rendre inhabitable, à transformer les forêts en déserts. Et en plus, nous avons créé des mégapoles – je suis allé à São Paulo, Tokyo, Mexico City – où les gens s’entassent et qui sont des nids de discorde. Je le vois d’une manière objective et je lance un cri d’alarme. Si on continue dans cette direction, ce sera la catastrophe, l’apocalypse.
L’homme ne réfléchit pas à l’avenir, ne s’en préoccupe pas. Même pas les dirigeants politiques, pour qui, ce qui compte, est la date des prochaines élections, dans deux ou trois ans maximum. Lorsque j’étais enfant, on vivait un peu comme si le monde nous était donné, sans préoccupation : le monde était là pour nous servir et être exploité par l’homme. Ce n’est vraiment qu’à la fin de la dernière guerre qu’on s’est rendu compte brusquement que les ressources naturelles étaient finies, qu’elles risquaient d’être épuisées rapidement par le développement de l’humanité et que les conditions de vie allaient être fort diminuées. »
C’est là que nous mène le progrès régressif : dans le mur. C’est donc maintenant, et pas demain, qu’il faut trouver le moyen de s’extraire de cette nasse. On attend avec intérêt le premier politique qui osera déclarer : « Chers compatriotes, je vous annonce la fin de la croissance, qui est devenue un leurre. Enfin débarrassés de ce boulet et de ses corollaires, l’austérité et la rigueur, nous allons maintenant nous orienter vers une nouvelle période de bonheur. »
Dans l’intervalle, on nous vend de l’intelligence artificielle et de transhumanisme comme si de rien n’était. Encore bravo, et merci.
Il semble que vous appréciez cet article
Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.
Merci !
[1] Cf. Patrick Willemarck, in Les savoirs à l'épreuve, Liberté J’Ecris Ton Nom, Bruxelles, 2014
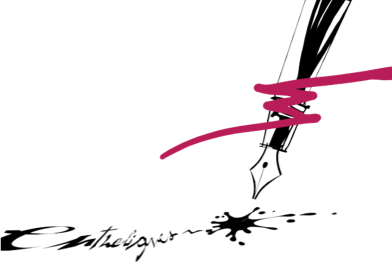
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.
Chaque samedi le meilleur de la semaine.
/ Du même auteur /
-

Détachez-vous des achats!
-

Noyer l’poisson dans l’pétrole
-

Noël c’est…
-

Tapin au pays de l'or noir
-

Comme des hyènes
-

Exodus septante-six +
-

Vert j’espère, mieux je veux
-

Climat : pauvres de nous !
-

Click and go exstream !
-

Une sale affaire
/ humeurs /
/ photos /
/ Commentaires /
Avant de commencer…
Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.
Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement.
Pour en savoir plus, cliquez ici.